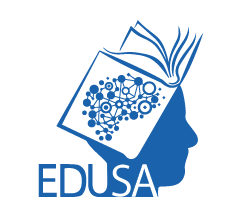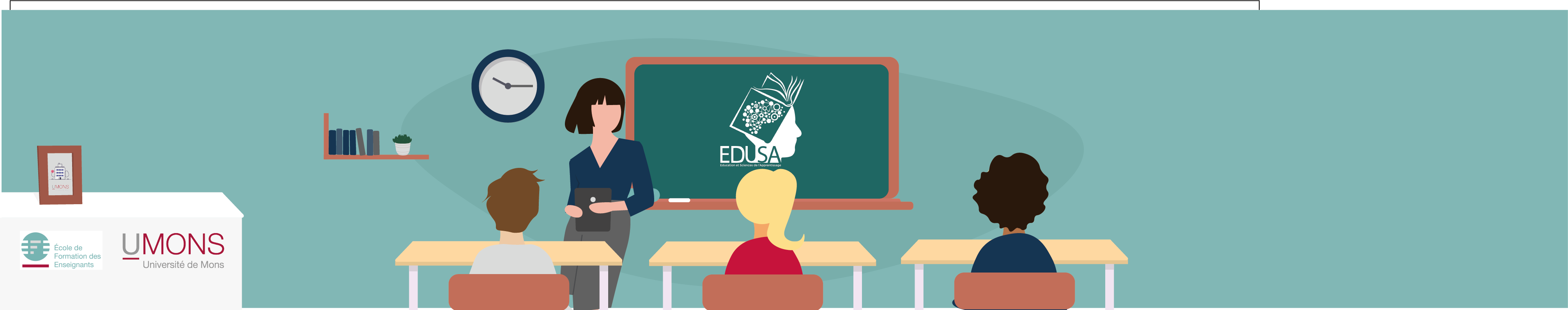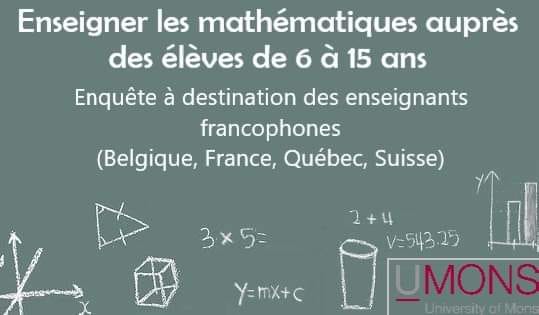Référence : Duroisin, N. (2019). L’avenir de la neuroéducation. LUMONS-élément n°31 (fév. – av.), p. 6-8.
« Comment fonctionne le cerveau de mes élèves ? » ; « Que se passe-t-il dans la tête de mes élèves quand ils apprennent ? » ; « Pourquoi mes élèves oublient-ils ce qu’ils ont appris ? » ; « Comment favoriser de meilleurs apprentissages ? » ; « Les recherches menées en psychologie cognitive et neurosciences peuvent-elles m’aider à mieux enseigner ? » ; … autant de questions fondamentales qui restent bien souvent sans réponse. Certaines ont été données le mardi 12 février lors d’une journée d’étude destinée à l’ensemble des acteurs du système éducatif et organisée à l’UMONS dans le cadre du « Pacte pour un Enseignement d’Excellence » par l’Institut d’Administration Scolaire (INAS). Natacha Duroisin, Docteure en Sciences psychologiques et de l’Education et organisatrice de cette manifestation, répond à nos questions autour du thème « Mieux comprendre le fonctionnement cognitif des élèves pour mieux ajuster les pratiques pédagogiques ».
La thématique du développement cognitif a été choisie parce qu’elle constitue un des axes de recherche de l’Institut d’Administration scolaire (INAS). Cet institut, dirigé par le Professeur Marc Demeuse, est impliqué dans de multiples projets de recherche nationaux et internationaux visant notamment le développement d’outils ou de situations d’enseignement-apprentissage et la formation des enseignants, explique Natacha Duroisin. Afin d’amener l’enseignant à produire tout support (au sens large) permettant à ses élèves d’apprendre, il est nécessaire que celui-ci dispose de connaissances en psychologie cognitive, en psychologie développementale et soit également informé des dernières avancées dans le domaine des neurosciences cognitives. On part donc du principe qu’« il est nécessaire de connaître le fonctionnement et le développement cognitif des élèves pour pouvoir enseigner plus efficacement ». Nous avons fait de ce principe, l’objet d’une journée d’étude. Cette thématique correspond également aux demandes et besoins actuels rencontrés par les intervenants du monde scolaire : ce n’est pas pour rien si nous avons aussi rapidement dû afficher complet ! Nous avons reçu des futurs enseignants, des enseignants du maternel, du primaire, du secondaire, des directions, des membres de l’inspection mais également des psychologues, des formateurs de Haute-Ecole, des professeurs d’Université et des chercheurs. L’objectif de la journée était de décrire et d’expliciter, au moyen d’illustrations concrètes, certains des mécanismes cognitifs et conatifs liés aux principaux apprentissages qu’un individu doit parvenir à acquérir et exercer tout au long de sa scolarité et au-delà. Il n’y a pas de recettes miracles données toutes faites. Il y a un certain nombre de pratiques à favoriser compte tenu du développement et du fonctionnement cognitif qu’il faut expérimenter sur le terrain, en contexte scolaire, pour ensuite en constater les effets dans le chef des élèves ».
Peut-on parler d’un réel engouement pour le domaine des neurosciences et ses apports dans le milieu éducatif ?
On parle même de « neuroéducation » ou encore de « neurosciences éducatives ». Il est par exemple aujourd’hui possible, grâce à l’Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf), de mesurer les activités cérébrales d’un individu qui réalise une tâche cognitive particulière, en d’autres termes « de voir ce qui jusqu’alors n’était pas visible, c’està-dire l’activité du cerveau, quand un individu exécute une tâche ou apprend ». On peut donc étudier les mécanismes cérébraux impliqués dans les apprentissages scolaires et liés à l’enseignement afin de mieux comprendre le développement et le fonctionnement du cerveau des élèves. In fine, la compréhension des liens entre les processus neurocognitifs et les apprentissages permettent d’apporter, d’une part, de nouvelles opportunités d’amélioration des pratiques d’enseignement et, d’autre part, des pistes de solution à certaines problématiques éducatives (troubles spécifiques d’apprentissage, par exemple).
Comment en est-on arrivé à cette évolution progressive du « Qu’est-ce que j’apprends ? » vers le « Comment j’apprends ? »
Si on pensait autrefois qu’un bon enseignement était principalement lié aux qualités intrinsèques de l’enseignant, autrement dit, qu’un bon enseignant suffisait ; on sait aujourd’hui qu’il ne suffit plus seulement d’enseigner et de savoir enseigner, il faut également que les élèves apprennent. En matière d’évaluation, ce changement peut également être remarqué bien qu’il soit plus récent et pose plusieurs défis de taille. Si auparavant, l’évaluation portait exclusivement sur les contenus, c’està-dire les savoirs notionnels enseignés, l’évaluation tend, à présent, à prendre davantage en considération les processus cognitifs mis en œuvre par les élèves. L’intérêt est, par exemple, d’adapter l’évaluation aux capacités cognitives de l’élève : on ne peut pas évaluer n’importe quelle acquisition à n’importe quel âge ! Pour parvenir à faire apprendre ses élèves et les évaluer, il est donc nécessaire que l’enseignant connaisse le développement et le fonctionnement du cerveau de ses élèves lorsque ceux-ci sont confrontés à différentes tâches requérant des capacités d’attention, de raisonnement, d’inhibition…
Est-ce pour autant la panacée à un apprentissage forcément plus efficace ?
Si cette approche bénéficie, pour l’instant, d’un réel enthousiasme auprès d’une large population, il est important que chacun fasse preuve d’esprit critique quant aux pratiques annoncées comme « révolutionnaires puisque basées sur des résultats de neurosciences ». Il serait, en effet, illusoire de croire que les neurosciences apportent, de facto, des recettes magiques aux enseignants. Il y a un chemin non négligeable à parcourir entre le laboratoire et la classe avant d’aboutir à la proposition de recommandations pédagogiques. De plus, il s’avère judicieux de mettre en perspective les récents résultats obtenus dans le champ de la neuroéducation avec les connaissances et théories mises en lumière par d’autres champs de recherche. En effet, les neurosciences cognitives ne sont pas les seules sciences à contribuer à l’avancement des connaissances en ce qui concerne le fonctionnement neurocognitif de l’individu. La psychologie développementale et la psychologie cognitive, deux champs disciplinaires qui s’ancrent dans des dizaines années d’expérimentations et de confirmations, sont également à considérer quand on veut comprendre le développement et le fonctionnement cognitif des individus.
Est-il vraiment possible de mieux comprendre le fonctionnement cognitif de l’élève pour mieux ajuster les pratiques pédagogiques des enseignants ? Pouvez-vous donner quelques exemples concrets ?
Oui, cela est possible. Les connaissances cumulées dans les domaines des neurosciences et de la psychologie cognitive ont, par exemple, permis de démontrer qu’apprendre nécessite de la pratique et de la répétition. Pour qu’il y ait apprentissage, il faut qu’il y ait « réactivation neuronale ». Si l’apprenant cesse de réaliser régulièrement des exercices, les neurones ne seront plus mobilisés, ne s’activeront plus pendant un certain laps de temps et les connexions neuronales associées à certains apprentissages s’affaibliront progressivement jusqu’à ce que les neurones se déconnectent les uns des autres. L’enseignant doit donc proposer des tâches qui impliquent des savoirs ou des habiletés spécifiques afin que l’apprenant soit engagé cognitivement. Il doit, par exemple, questionner les élèves, les interroger très régulièrement et demander à certains élèves d’enseigner ce qu’ils ont compris à d’autres élèves. Ces activités spécifiques permettent la réactivation neuronale et jouent un rôle important dans la consolidation des apprentissages. Les résultats des recherches montrent également que les neurones liés aux apprentissages se réactivent lors des périodes de repos. Concrètement, cela doit amener l’enseignant à planifier différemment ses cours. Il est ainsi préconisé d’espacer les périodes d’apprentissage : répartir les séances d’apprentissage sur de courtes périodes, éviter de regrouper les périodes d’enseignement sur un même sujet et donner des exercices à faire qui sollicitent des contenus enseignés antérieurement.
Avez-vous d’autres exemples ?
Dans un autre domaine plus spécifique, celui des apprentissages spatiaux, de récentes recherches réalisées en neurosciences ont mis en évidence que les individus qui utilisent une stratégie spatiale (c’està-dire ceux qui élaborent et utilisent des cartes cognitives à l’aide de repères et d’indices visuels pour notamment déterminer où ils se trouvent et où ils veulent se rendre) sont les seuls sujets à présenter une activité significative de l’hippocampe. À contrario, il a été remarqué une diminution de l’activité cérébrale chez ceux qui utilisent une stratégie de type stimulus-réponse—stratégie basée sur l’accomplissement de façon automatique de trajets—sans qu’une attention particulière soit portée à l’environnement. Le fait inquiétant est qu’il a été démontré que les individus ont de moins en moins recours à la stratégie spatiale avec l’âge. Les recherches que nous avons menées en psychologie cognitive ont confirmé et affiné ce résultat. Nous avons pu démontrer, via des exercices d’observation et de reproduction dans des environnements virtuels paramétrés, qu’à partir de 10-11 ans, la stratégie spatiale préférentiellement adoptée était une stratégie de type stimulus-réponse. Très concrètement, cela signifie que les enseignants de maternelle, primaire et de secondaire doivent aiguiser le sens de l’observation du détail des apprenants afin de faire travailler correctement le cerveau. Il faut notamment sensibiliser les élèves à l’espace qui les entoure ; en classe ou en dehors de celle-ci, prendre le temps de faire remarquer aux élèves que l’espace est composé d’une multitude d’objets aux couleurs et formes variées ; lors de sorties, demander aux élèves de prêter une attention particulière à l’emplacement des repères qui composent l’environnement ; réfléchir à de nouveaux itinéraires ; en mathématiques, opter pour l’utilisation de Réglettes Cuisenaires, faites découvrir les notions de distance en les faisant parcourir physiquement…
Pensez-vous que le monde éducatif dans son ensemble, y compris l’université, a suffisamment pris conscience de l’intérêt qu’il y a à prendre en considération le lien entre développement cognitif et pratiques pédagogiques ?
En tout cas, nous sommes aujourd’hui dans un contexte propice à cette prise de conscience. Les récentes découvertes réalisées dans le domaine des neurosciences et l’engouement pour ce champ de recherche amènent les acteurs du monde éducatif à se poser de nouvelles questions sur leurs pratiques pédagogiques, à reconsidérer leurs habitudes pédagogiques et, pour certains, à s’essayer à un « nouveau métier », celui d’ « enseignant-expérimentateur ». Le monde de l’éducation commence tout doucement à prendre conscience du fait qu’on ne peut pas bâtir des connaissances de manière durable et efficace sur du sable et qu’il convient donc, pour pouvoir mieux enseigner, de comprendre et de prendre en compte le fonctionnement et le développement cognitif des élèves. À partir de ce moment, les enseignants ouvrent également la porte à la psychologie cognitive et la psychologie développementale. Le monde académique doit également se sentir concerné par le lien à tisser entre le développement cognitif des étudiants et la mise en place de pratiques pédagogiques. Une récente découverte en neurosciences montre, en effet, que le cerveau termine son développement et arrive à maturité vers l’âge de 25-30 ans.
Référence : Duroisin, N. (2019). L’avenir de la neuroéducation. LUMONS-élément n°31 (fév. – av.), p. 6-8.